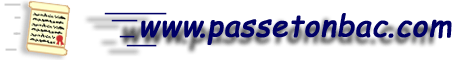
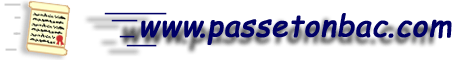
SERIE S
SUJET NATIONAL - JUIN 1998
PHILOSOPHIE
Sujet : Comment décider qu'un acte est juste ?
CORRIGE
Ce corrigé n'est pas un corrigé officiel. C'est un travail réalisé par l'auteur du site, il peut servir de base pour tout essai et peut être retouché en fonction de vos idées. Vous pouvez trouver un autre corrigé de ce sujet (et d'autres sujets de philosophie) sur le site www.maths.netIntroduction :
Les actes de la vie courante qui nous amènent à prendre des décisions en fonction de jugements personnels ou de contraintes dûes à la loi sont nombreux . Dans le monde de l'enseignement par exemple, cela peut être la notation de la copie d'un élève ; dans le monde du travail, cela va jusqu' à la décision du montant du salaire des employés... Quand aux juges des tribunaux, ils peuvent décider du nombres d'années qu'un homme devra passer en prison ! La décision de tels actes peut bien évidemment paraître juste pour certains et tout le contraire pour d'autres. Aussi, comment décider qu'un acte est juste, se référer à la loi suffit-il pour prendre une décision "juste" ?
Partie I :
Idée
: définir la justesse d'un acte uniquement par rapport à soi ,
c'est du despotisme ! Aussi, il faut s'en remettre à la loi.
"La
liberté des uns s'arrête la où commence celle des autres".
Cette maxime signifie tout simplement qu'on ne peut dès le départ
définir la justesse d'un acte que par rapport à soi et à
ses intérêts. C'est pourquoi dans toute civilisation, se crée
un cadre législatif ,qui à base de lois, va permettre d'aider
aux décisions de la vie courante.
Aussi, pour déterminer la
justesse d'un acte, on peut s'en remettre à la loi institutionnelle ou
à des décisions communes prétablies. La notation d'un élève
se fera en fonction d'un barème par exemple, le salaire d'un employé
se fera en fonction d'indices prenant en compte des minimums requis, des durées
horaires de travail... Et la justice des tribunaux se rend sur la base du droit
constitutionnel.
Partie 2 :
Idée
: S'en remettre à la loi, est-ce la bonne solution ?
De fait, si l'on
regarde les différentes civilisations humaines, on constate que les codes
de droit évoluent dans l'histoire. En France, par exemple, en 1841, la
loi interdisait le travail des enfants en dessous de l'âge de 8 ans...
Il pouvait donc être "légal" qu'ils travaillent dès
cet âge, mais cet acte était il juste ? Aujourd'hui, beaucoup diraient
que non, ne serait ce que d'un point de vue morphologique.
Et si les lois
évoluent dans l'histoire, elles ne sont pas les mêmes non plus
d'un pays à l'autre. Là encore, on peut citer qu'actuellement
dans la très grande majorité des pays en voie de développement,
l'âge légal pour le travail des enfants est de 14 ans (minimum
légal fixé par les nations unies) ce qui n'est pas le cas en France.
"La
loi du plus fort est toujours la meilleur". Cette maxime nous rappelle
que la loi est elle aussi déterminée par les hommes et on peut
s'interroger sur les motivations et pressions qui s'exercent sur ceux qui définissent
la loi ou la modifient. On peut citer l'intervention des groupes de pression
(les lobbies) de divers secteurs industriels ou financiers qui agissent sur
les gouvernements et les élus pour modifier la loi en fonction de leurs
intérêts.
Idée : Relativiser le recours
à la loi car ce qui est définit comme "juste" par la
loi est parfois conventionnel.
La codification de l'acte juste relève
d'une convention entre les hommes, liée à des circonstances données
; en dehors de cette convention, le recours à la loi n'est plus valable.
La définition de "l'acte juste" finalement résulte d'un
accord entre les hommes, il représente l'intérêt de la collectivité
et est par conséquent conventionnel.
Partie 3
Idée
: La justice comme un modèle
Si on ne peut s'en remettre aux lois
comme instruments infaillibles pour juger d'un acte en un lieu et en un temps
donné, alors il faut s'intéresser à la justice en tant
que modèle. Kant déclare à ce propos que "la justice
est une exigence universelle qui anime nécessairement toute loi particulière".
Par conséquent un acte sera juste non pas seulement en fonction des lois
ou de notre vision des choses mais seulement si il est universalisable et ne
nuit à personne.
Conclusion
La loi a pour
vocation de réaliser la justice dans une situation donnée. La
justice est donc inséparable du droit mais elle ne peut cependant jamais
être réalisée en tant que telle car elle se doit être
universelle pour décider de l'acte.